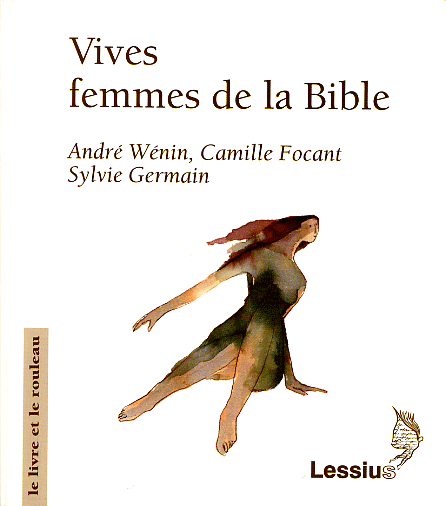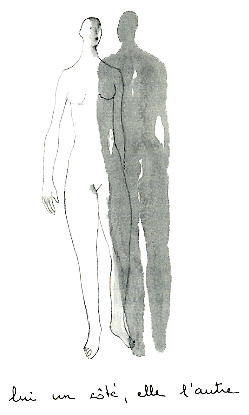Il en est ainsi en particulier des femmes qui peuplent les nombreux récits des deux Testaments. La plupart du temps, elles semblent confinées dans l'ombre de protagonistes masculins qui font mine de contrôler les choses. Elles n'en jouent pas moins un rôle déterminant. Car elles se tiennent là où, à l'abri des regards, se posent les choix qui engagent l'avenir. Presque toujours prêtes à défendre la vie, elles savent s'y prendre pour lui éviter de s'enliser dans les impasses de l'injustice, de la violence. Et leur audace n'a souvent d'égale que leur grandeur d'âme et leur discrétion.
C'est à ces femmes de la Bible que ce petit livre est consacré : matriarche ou femme du monde, Israélite ou étrangère, reine ou servante, de grande ou de petite vertu, elles ont leur place ici, parmi ces portraits. Des esquisses, en réalité, qui n'ont d'autre prétention que d'inviter la lectrice, le lecteur, à revenir à l'une ou l'autre page du Livre, pour se laisser surprendre par la femme qui s'y est glissée. Oui, relire attentivement ce qui est raconté d'Ève et de Marie, de Tamar ou de Ruth, de Bethsabée ou de Marie-Madeleine, à l'aide de quelques clefs destinées à « ouvrir» le texte, à y ébaucher un chemin.
À l'origine de ce livre, il y a une demande du directeur de la revue Croire aujourd'hui : une douzaine de textes brefs sur un thème biblique. Peu de temps avant, j'avais découvert avec un intérêt ravi les Cinquante portraits bibliques de Paul Beauchamp (Paris, Seuil, 2000), portraits dont bon nombre avaient paru d'abord dans cette revue jésuite française. Ce livre m'avait laissé un regret, toutefois. Dans cette «histoire sainte» contemporaine, les femmes restaient dans l'ombre de leurs congénères masculins. La demande de Paul Legavre m'a donné envie de leur faire place, en tentant modestement de me couler dans le genre littéraire si fort et si suggestif des Cinquante portraits.
Douze «portraits» ont ainsi paru dans Croire aujourd'hui, en 2003 et 2004. À mesure qu'ils s'écrivaient et paraissaient, a germé peu à peu l'idée d'une galerie un peu plus fournie, d'un petit livre. Acquis à cette idée, un collègue et ami, Camille Focant, spécialiste réputé de l'Évangile de Marc, a bien voulu croquer le portrait de l'une ou l'autre femme du Nouveau Testament. Nous nous sommes donc retrouvés avec ces portraits. Vingt-deux portraits. C'est alors que les échanges avec les Éditions Lessius ont fait naître l'idée d'associer deux femmes au projet. Marte Sonnet ménagerait des espaces de respiration par une série d'encres où sa sensibilité artistique ferait écho à la finesse de l'art narratif qui a donné naissance aux récits bibliques. Sylvie Germain, quant à elle, proposerait sa lecture de l'ensemble pour nourrir le dialogue avec la lectrice, le lecteur. Toutes deux ont accepté - et je saisis l'occasion pour les en remercier - de relever le défi pour que vous puissiez tenir en main ce petit livre auquel les Éditions Lessius ont apporté tout le soin et le savoir-faire qu'on leur connaît.
Inutile, quand on esquisse un portrait, de vouloir faire le tour du personnage. Les traits principaux agencés avec justesse suffisent à croquer l'allure, la mimique, l'expression. Sans tomber dans la caricature, le portrait sait donner le relief qu'il faut pour que ressortent les lignes de force. Les textes proposés ici sont de ce type. Volontairement brefs, allusifs, incisifs même. Loin de chercher à tout dire, ils optent délibérément pour la netteté du trait qui mettra en lumière une caractéristique essentielle. Sans forcément sauter aux yeux, celle-ci n'en façonne pas moins le personnage et donne à son action sa consistance singulière.
Ce désir d'aller à l'essentiel explique le caractère calibré, presque standardisé de la forme. Ce qui, au départ, était une exigence éditoriale propre à une revue grand public s'est mué en une forme d'autodiscipline : se contraindre à ne garder que l'essentiel, à donner du nerf au langage ; chercher à saisir les articulations principales et ne retenir du détail que ce qui met celles-ci en relief, selon la lame de fond du récit biblique. À cet effet, celui-ci a été étudié avec grande attention. Mais cette étude, sa méthode, ses détours, ses hésitations resteront à l'arrière-plan. Car le livre se veut moins une exégèse des récits bibliques qu'une invitation à les lire. À se prêter à ce jeu, la lectrice, le lecteur, risque de les découvrir avec des yeux neufs, peut-être même - on peut l'espérer - avec un regard différent que celui qui est ici proposé.
Car les portraits ne sont pas le tout du livre. Les encres qui en scandent la galerie ouvrent des espaces. Avant de reprendre la lecture ou de fermer le livre, la lectrice, le lecteur, pourra s'y retrouver en compagnie de ces femmes d'autrefois et de toujours, qui ont bien plus à dire que ce qui est esquissé par le texte. Au hasard des pages, lectrice et lecteur pourront trouver quelques-unes de ces femmes en train de dialoguer, et, discrètement, se mêler à leur conversation... Au terme - ou entre deux portraits -, la postface proposera d'autres avenues encore par le jeu d'échos qu'elle orchestre. La voix d'une femme d'aujourd'hui s'y mêlera à celles qui nous viennent du fond des âges, si proches pourtant de nos joies et de nos angoisses, de nos choix et de nos refus, de nos désirs et de nos peurs. De notre vie. Peut-être ces dernières pages susciteront-elles à leur tour d'autres réflexions, d'autres dialogues. Et le désir - qui sait ? d'aller relire encore le Livre.
ANDRÉ WÉNIN.